
"Made in China"
Bien que la Chine soit membre de l'OMC depuis 2001 et ait largement profité de l'accès aux marchés mondiaux, Pékin a parallèlement mis en place des politiques industrielles et commerciales qui privilégient le « Made in China » et désavantagent souvent les concurrents étrangers. Ces mesures vont bien au-delà des droits de douane traditionnels et incluent des outils réglementaires, des exigences techniques, des conditions sur les investissements et des subventions ciblées.
L'une des stratégies phares a été le plan Made in China 2025, lancé en 2015, qui ambitionne de faire de la Chine un leader mondial dans dix secteurs industriels stratégiques (de la robotique à l'aérospatiale, des véhicules à nouvelles énergies à la biotechnologie). Le plan fixait des objectifs quantitatifs ambitieux, notamment porter à 70 % d'ici 2025 la part des composants et matériaux de base produits localement dans les secteurs de haute technologie. En pratique, cela impliquait un fort élan pour l'innovation indigène et la substitution des importations, remplaçant progressivement les technologies avancées importées par des équivalents fabriqués en Chine.
Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement chinois a mobilisé des outils tels que des fonds spéciaux pour la recherche et le développement, des incitations fiscales pour les entreprises high-tech, des financements avantageux via les banques publiques et une protection accrue du marché intérieur dans ces secteurs.
Par exemple, dans le domaine des véhicules électriques, pendant plusieurs années, les constructeurs automobiles souhaitant accéder aux subventions gouvernementales devaient utiliser des batteries fournies par des producteurs locaux sélectionnés (excluant de facto de nombreux fournisseurs étrangers). Cette exigence, en vigueur de 2015 à 2019, garantissait qu'une grande partie de la chaîne de valeur reste entre des mains chinoises et constitue un exemple emblématique de protection non tarifaire mise en œuvre par des normes techniques.
L'une des stratégies phares a été le plan Made in China 2025, lancé en 2015, qui ambitionne de faire de la Chine un leader mondial dans dix secteurs industriels stratégiques (de la robotique à l'aérospatiale, des véhicules à nouvelles énergies à la biotechnologie). Le plan fixait des objectifs quantitatifs ambitieux, notamment porter à 70 % d'ici 2025 la part des composants et matériaux de base produits localement dans les secteurs de haute technologie. En pratique, cela impliquait un fort élan pour l'innovation indigène et la substitution des importations, remplaçant progressivement les technologies avancées importées par des équivalents fabriqués en Chine.
Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement chinois a mobilisé des outils tels que des fonds spéciaux pour la recherche et le développement, des incitations fiscales pour les entreprises high-tech, des financements avantageux via les banques publiques et une protection accrue du marché intérieur dans ces secteurs.
Par exemple, dans le domaine des véhicules électriques, pendant plusieurs années, les constructeurs automobiles souhaitant accéder aux subventions gouvernementales devaient utiliser des batteries fournies par des producteurs locaux sélectionnés (excluant de facto de nombreux fournisseurs étrangers). Cette exigence, en vigueur de 2015 à 2019, garantissait qu'une grande partie de la chaîne de valeur reste entre des mains chinoises et constitue un exemple emblématique de protection non tarifaire mise en œuvre par des normes techniques.
D'autres mesures protectionnistes concernent les conditions imposées aux investisseurs étrangers.
Historiquement, la Chine a conditionné l'accès à son marché à des coentreprises obligatoires avec des partenaires locaux dans des secteurs comme l'automobile, exigeant souvent un transfert de technologie. Cette pratique, perçue par les États-Unis et l'UE comme un transfert forcé de savoir-faire, a été une source majeure de tensions commerciales. Bien que Pékin ait récemment assoupli certaines de ces contraintes (depuis 2022, par exemple, les constructeurs automobiles étrangers peuvent opérer sans partenaire local), cette libéralisation est intervenue seulement après que les entreprises chinoises ont comblé leur retard technologique et acquis des positions avantageuses dans des secteurs comme les voitures électriques. De plus, de nombreux secteurs restent interdits ou fortement réglementés pour les entreprises étrangères via la « Liste négative » sur les investissements étrangers, qui restreint ou prohibe la participation étrangère dans des domaines sensibles (énergie, télécommunications, médias, etc.).
La Chine utilise également des barrières réglementaires et des normes techniques comme outils de protectionnisme déguisé. Le contrôle étatique d'Internet – le célèbre Great Firewall – n'est pas seulement une mesure politique, mais a eu pour effet collatéral de protéger l'émergence de géants technologiques nationaux (Alibaba, Tencent, Baidu, etc.) face à l'entrée de concurrents occidentaux, créant un écosystème numérique entièrement chinois. De même, les exigences en matière de cybersécurité et de localisation des données obligent des entreprises comme les banques ou les opérateurs technologiques à adopter des solutions TIC domestiques considérées comme « sûres et contrôlables », marginalisant les fournisseurs étrangers.
Cette tendance s'est accélérée récemment : face aux restrictions américaines sur l'exportation de technologies avancées, Pékin a lancé des programmes de remplacement à grande échelle des technologies occidentales par des alternatives chinoises. Entre septembre 2022 et septembre 2023, le nombre d'appels d'offres publics chinois visant à « nationaliser » les équipements technologiques (dans les ministères, les entités publiques et les grandes SOE) a plus que doublé (de 119 à 235), et la valeur des contrats correspondants a triplé. En 2022 seulement, la Chine a dépensé 1,4 trillion de yuans (environ 191 milliards de dollars) pour remplacer les matériels et logiciels étrangers par des produits domestiques, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Cet effort massif concerne des domaines critiques comme les systèmes informatiques dans l'administration publique, les infrastructures réseau (5G, cloud) et, prochainement, les secteurs bancaire et des télécommunications, avec l'objectif déclaré de réduire les vulnérabilités géopolitiques et les risques d'espionnage informatique.
La Chine utilise également des barrières réglementaires et des normes techniques comme outils de protectionnisme déguisé. Le contrôle étatique d'Internet – le célèbre Great Firewall – n'est pas seulement une mesure politique, mais a eu pour effet collatéral de protéger l'émergence de géants technologiques nationaux (Alibaba, Tencent, Baidu, etc.) face à l'entrée de concurrents occidentaux, créant un écosystème numérique entièrement chinois. De même, les exigences en matière de cybersécurité et de localisation des données obligent des entreprises comme les banques ou les opérateurs technologiques à adopter des solutions TIC domestiques considérées comme « sûres et contrôlables », marginalisant les fournisseurs étrangers.
Cette tendance s'est accélérée récemment : face aux restrictions américaines sur l'exportation de technologies avancées, Pékin a lancé des programmes de remplacement à grande échelle des technologies occidentales par des alternatives chinoises. Entre septembre 2022 et septembre 2023, le nombre d'appels d'offres publics chinois visant à « nationaliser » les équipements technologiques (dans les ministères, les entités publiques et les grandes SOE) a plus que doublé (de 119 à 235), et la valeur des contrats correspondants a triplé. En 2022 seulement, la Chine a dépensé 1,4 trillion de yuans (environ 191 milliards de dollars) pour remplacer les matériels et logiciels étrangers par des produits domestiques, soit une hausse de 16 % par rapport à l'année précédente. Cet effort massif concerne des domaines critiques comme les systèmes informatiques dans l'administration publique, les infrastructures réseau (5G, cloud) et, prochainement, les secteurs bancaire et des télécommunications, avec l'objectif déclaré de réduire les vulnérabilités géopolitiques et les risques d'espionnage informatique.
Un autre aspect du protectionnisme « Made in China » est le recours à des subventions distorsives à l'exportation et au dumping commercial
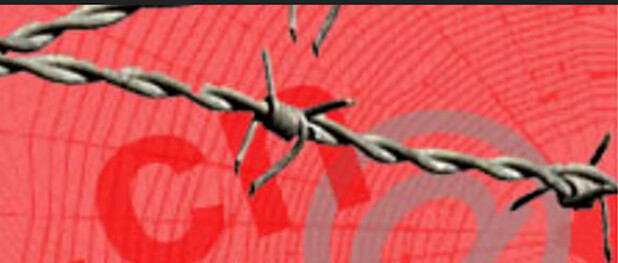
Les excédents de production intérieure dans des industries comme l'acier, l'aluminium, les panneaux solaires ou, plus récemment, les batteries et les véhicules électriques, sont souvent absorbés par les marchés étrangers à des prix très compétitifs grâce au soutien public. Cela a suscité des réactions de la part des partenaires commerciaux : l'Union européenne, par exemple, a lancé en 2023 une enquête sur les subventions chinoises aux voitures électriques importées, prévoyant d'éventuels droits compensatoires pour protéger les producteurs européens.
Les États-Unis, dès 2018, avaient imposé des droits sur l'acier et l'aluminium (touchant également la Chine) ainsi qu'une série de tarifs punitifs sur des centaines de milliards de dollars de biens chinois, accusant Pékin de pratiques déloyales et protectionnistes. La Chine, en retour, a riposté avec des droits équivalents sur des produits américains et a continué à soutenir vigoureusement ses entreprises exportatrices, illustrant une approche mercantiliste de « rivalité économique ».
Voici quelques-unes des principales initiatives et politiques chinoises visant à renforcer l'industrie nationale et l'autosuffisance ces dernières années.
Comme on peut le constater, la Chine combine réformes internes, plans industriels et outils juridiques pour poursuivre une forme de protectionnisme moderne, axée sur l'innovation nationale et la résilience économique. Bien que différente du protectionnisme tarifaire classique, cette approche a des effets tout aussi significatifs sur les équilibres commerciaux mondiaux et est perçue par de nombreuses économies avancées comme un défi au principe de réciprocité sur les marchés.
Les États-Unis, dès 2018, avaient imposé des droits sur l'acier et l'aluminium (touchant également la Chine) ainsi qu'une série de tarifs punitifs sur des centaines de milliards de dollars de biens chinois, accusant Pékin de pratiques déloyales et protectionnistes. La Chine, en retour, a riposté avec des droits équivalents sur des produits américains et a continué à soutenir vigoureusement ses entreprises exportatrices, illustrant une approche mercantiliste de « rivalité économique ».
Voici quelques-unes des principales initiatives et politiques chinoises visant à renforcer l'industrie nationale et l'autosuffisance ces dernières années.
Comme on peut le constater, la Chine combine réformes internes, plans industriels et outils juridiques pour poursuivre une forme de protectionnisme moderne, axée sur l'innovation nationale et la résilience économique. Bien que différente du protectionnisme tarifaire classique, cette approche a des effets tout aussi significatifs sur les équilibres commerciaux mondiaux et est perçue par de nombreuses économies avancées comme un défi au principe de réciprocité sur les marchés.
Impact sur les relations internationales : entre conflits commerciaux et concurrence technologique
L'assertivité économique de Pékin et ses politiques nationalistes ont eu un impact profond sur les relations avec les autres grandes puissances, en premier lieu les États-Unis et l'Union européenne. Les frictions commerciales et technologiques sont devenues des éléments centraux de leurs agendas diplomatiques respectifs, générant des tensions mais aussi redéfinissant les alliances et les stratégies.
Relations Chine-États-Unis. La relation économique entre la Chine et les États-Unis est passée, au cours de la dernière décennie, d'un paradigme d'intégration symbiotique à une compétition stratégique ouverte. Les États-Unis reprochent à la Chine d'avoir profité de l'ordre commercial libéral (OMC) sans en respecter pleinement les règles, à travers des pratiques telles que des subventions massives, des transferts forcés de technologie et des restrictions à l'accès des entreprises américaines en Chine.
De son côté, Pékin perçoit les initiatives de Washington – notamment sous l'administration Trump et partiellement poursuivies sous Biden – comme une tentative de containment de son ascension économique et technologique. La guerre commerciale déclenchée en 2018 a marqué un tournant : les États-Unis ont imposé des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d'importations chinoises (jusqu'à 25 % sur de nombreux produits), et la Chine a répondu par des tarifs symétriques sur des biens américains.
En 2023, malgré quelques signes d'apaisement partiel, le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine restait colossal (plus de 279 milliards de dollars), et la Chine demeurait l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, avec des échanges totaux oscillant entre 575 et 580 milliards de dollars. Cet échange, bien que réduit par rapport au pic d'avant la guerre commerciale, met en lumière la profonde interdépendance persistant entre les deux économies, rendant un découplage complet complexe.
Relations Chine-États-Unis. La relation économique entre la Chine et les États-Unis est passée, au cours de la dernière décennie, d'un paradigme d'intégration symbiotique à une compétition stratégique ouverte. Les États-Unis reprochent à la Chine d'avoir profité de l'ordre commercial libéral (OMC) sans en respecter pleinement les règles, à travers des pratiques telles que des subventions massives, des transferts forcés de technologie et des restrictions à l'accès des entreprises américaines en Chine.
De son côté, Pékin perçoit les initiatives de Washington – notamment sous l'administration Trump et partiellement poursuivies sous Biden – comme une tentative de containment de son ascension économique et technologique. La guerre commerciale déclenchée en 2018 a marqué un tournant : les États-Unis ont imposé des droits de douane sur des centaines de milliards de dollars d'importations chinoises (jusqu'à 25 % sur de nombreux produits), et la Chine a répondu par des tarifs symétriques sur des biens américains.
En 2023, malgré quelques signes d'apaisement partiel, le déficit commercial américain vis-à-vis de la Chine restait colossal (plus de 279 milliards de dollars), et la Chine demeurait l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis, avec des échanges totaux oscillant entre 575 et 580 milliards de dollars. Cet échange, bien que réduit par rapport au pic d'avant la guerre commerciale, met en lumière la profonde interdépendance persistant entre les deux économies, rendant un découplage complet complexe.
Giuseppe Gagliano a fondé en 2011 le réseau international Cestudec (Centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis), basé à Côme (Italie), dans le but d'étudier, dans une perspective réaliste, les dynamiques conflictuelles des relations internationales. Ce réseau met l'accent sur la dimension de l'intelligence et de la géopolitique, en s'inspirant des réflexions de Christian Harbulot, fondateur et directeur de l'École de Guerre Économique (EGE)
Il collabore avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) (Lien),https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/ et avec l'Université de Calabre dans le cadre du Master en Intelligence, et avec l'Iassp de Milan (Lien).https://www.iassp.org/team_master/giuseppe-gagliano/

 Accueil
Accueil
