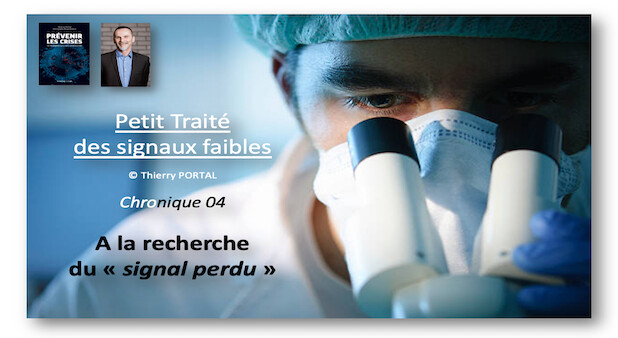
De fait, aborder la crise sous l’angle des signes annonciateurs implique d’adopter l’idée de son observation « microscopique », à la recherche de précieux indices préalables dont la difficile incubation est, par nature, complexe à interpréter. Tel un chercheur, le « laborantin » a pour fonction d’analyser des échantillons et prélèvements de toutes sortes en respectant d’abord des règles précises en matière d’hygiène pour garantir l’asepsie et la qualité d’étude et en utilisant ensuite des révélateurs chimiques et des outils technologiques parfois assez avancés afin de comprendre la formation d’une « soupe originelle ».
Son but est d’établir un compte-rendu final grâce à un protocole d’analyse précis. Alors prenons nos microscopes pour entrer dans « l’infiniment Avant », contrôlons la lumière à l’aide du diaphragme, ajustons l’oculaire grâce à notre vis micrométrique. Et endossons nos blouses blanches…
Son but est d’établir un compte-rendu final grâce à un protocole d’analyse précis. Alors prenons nos microscopes pour entrer dans « l’infiniment Avant », contrôlons la lumière à l’aide du diaphragme, ajustons l’oculaire grâce à notre vis micrométrique. Et endossons nos blouses blanches…

1ère règle du protocole d’observation : quel objectif d’étude faut-il suivre ? Selon quelles méthodes ?
Nous savons que, en l’absence d’une hypothèse clairement établie, la détection des signaux faibles est délicate, partant du principe qu’ils sont, par définition, fragmentaires et noyés dans un volume de données brutes souvent sans intérêt, parfois insolites au point de faire douter de leur fiabilité…
Ainsi, le « laborantin » n’ignore pas que l’aiguille qu’il cherche « dans une botte de foin » ne constitue qu’une brique élémentaire d’un possible événement, issue d’un immense faisceau d’indices préalables aux sources autant hétérogènes que, parfois, sujettes à caution : le signal faible demeure souvent une information fragmentaire, subtile et souvent ambiguë, sans pertinence intrinsèque et pouvant prendre des formes étonnantes, inutilisables et vides de sens. Pour la chercheuse en innovation S. Blanco[[1]] , « le signal faible ne consiste pas en des nombres et des faits précis puisqu’il (relève de) faits non encore survenus » ! Ici, l’on parle de « bribes, de rumeurs, de commentaires ou d’indications fragmentaires »… De fait, le paradoxe à relever est que le signal faible existe en fonction des interprétations qu’on lui accorde : à part l’intuition, rien n’indique au laborantin que ce qu’il cherche est en relation étroite, donc immédiatement utilisable, avec un risque pouvant affecter son organisation. A ce sujet, le consultant P. Cahen évoque « un fait paradoxal qui inspire réflexion » [[2]].
C’est pourquoi il doit mettre en place un protocole digne de toute « recherche scientifique ». Sur la base d’une « idée / intuition », la phase d’observation donnera lieu à l’élaboration d’une hypothèse, suivie d’une phase d’expérimentation qui permettra de compiler les données et informations susceptibles de conduire à leur interprétation, puis leur confirmation. Ce « long schéma laborieux du bon petit laborantin » doit pouvoir se répéter dans le temps afin de confirmer, ou non, les premiers résultats obtenus. Plusieurs étapes donc :
Ainsi, le « laborantin » n’ignore pas que l’aiguille qu’il cherche « dans une botte de foin » ne constitue qu’une brique élémentaire d’un possible événement, issue d’un immense faisceau d’indices préalables aux sources autant hétérogènes que, parfois, sujettes à caution : le signal faible demeure souvent une information fragmentaire, subtile et souvent ambiguë, sans pertinence intrinsèque et pouvant prendre des formes étonnantes, inutilisables et vides de sens. Pour la chercheuse en innovation S. Blanco[[1]] , « le signal faible ne consiste pas en des nombres et des faits précis puisqu’il (relève de) faits non encore survenus » ! Ici, l’on parle de « bribes, de rumeurs, de commentaires ou d’indications fragmentaires »… De fait, le paradoxe à relever est que le signal faible existe en fonction des interprétations qu’on lui accorde : à part l’intuition, rien n’indique au laborantin que ce qu’il cherche est en relation étroite, donc immédiatement utilisable, avec un risque pouvant affecter son organisation. A ce sujet, le consultant P. Cahen évoque « un fait paradoxal qui inspire réflexion » [[2]].
C’est pourquoi il doit mettre en place un protocole digne de toute « recherche scientifique ». Sur la base d’une « idée / intuition », la phase d’observation donnera lieu à l’élaboration d’une hypothèse, suivie d’une phase d’expérimentation qui permettra de compiler les données et informations susceptibles de conduire à leur interprétation, puis leur confirmation. Ce « long schéma laborieux du bon petit laborantin » doit pouvoir se répéter dans le temps afin de confirmer, ou non, les premiers résultats obtenus. Plusieurs étapes donc :
- 1) Etablir le périmètre d’observation : étudier la périphérie du sujet d’études, approfondir la connaissance d’évènements transformateurs situés sur d’autres domaines d’activités, accorder de l’importance et de la curiosité à des histoires parallèles… sont autant de pistes à suivre pour qui veut ausculter le potentiel de transformation de son organisation. Si elle se contente de mettre en place des sonars sur son seul champ d’activités, comment l’organisation peut-elle espérer déceler des micros changements porteurs de sens ? En bref, le « laborantin » doit élargir la focale d’observation en faisant des « pas de côté » !
- 2) Les sources : les signaux faibles peuvent provenir de diverses sources, y compris les médias sociaux, les blogs, les forums, les publications académiques, les brevets, les rapports économiques, et plus encore. Cette variabilité rend la détection plus complexe, car il faut surveiller un large éventail de sources d’information pour ne pas manquer ces précieux indices. Ainsi, le « laborantin » doit sélectionner les sources d’information les plus pertinentes : sources internes (comme les rapports financiers) et sources externes (comme les publications sectorielles, les médias sociaux, et les bases de données économiques). La diversité des sources d’informations garantit une vue d’ensemble complète, pourvu que les sonars mis en œuvre balaient le « spectre sonore » de façon non aléatoire. En bref, le choix et la multiplicité des sources constituent une partie essentielle du protocole de recherche !
- 3) Les « microscopes » utilisables : toutefois, les données sont désormais majoritairement non structurées, éparpillées « façon puzzle »[[3]] . Elles sont sans cesse partagées, entremêlées et co-construites, ce qui rend l’identification de la source d’information plus difficile. De plus, le fléau de la surabondance d’information engendre de nombreuses nuisances : fatigue informationnelle, voire atteinte des limites capacitaires de l’être humain, redondances informationnelles, contradictions des informations, biais de perception etc. Dans nos environnements technologiques de plus en plus ouverts et générateurs « d’infobésité », les outils de veille automatisée peuvent appuyer le laborantin pour agréger toujours davantage de données, issues d’une multitude de sources en temps réel. De plus, l’intelligence artificielle (IA) en recherche documentaire propose aujourd’hui robots conversationnels (ChatGpt, Gemini, Copilot, Claude, Mistral ou encore Perplexity), aides à la recherche (Bing, Google…) et assistants d’analyse (Semantic Scholar, Elicit, Consensus, Scopus’AI, Lateral ou encore Scite, Connected Papers, Litmaps et Research Rabbit). En bref, il s’agit de construire une capacité de recherche du signal perdu qui allie pilotage humain et utilisation raisonnée des technologies…
- 4) L’analyse des données : faire des corrélations entre les données et les faits pour en extraire du « sens commun » n’est pas simple, surtout si l’on part du principe que le « laborantin » a la lourde responsabilité de distinguer les signaux pertinents du bruit de fond et de comprendre les implications de ces signaux pour l’organisation. Pour ce faire, l’utilisation de techniques d’analyse avancées peut l’aider à surmonter la surabondance des signaux, les biais statistiques, la déformation liés aux réseaux sociaux (analyse de tendances, analyse prédictive, social listening pour les réseaux sociaux, machine ou deep learning). De plus, les systèmes d’organisation des connaissances (SOC) présentent cet avantage d’englober « tous les types de schémas permettant d’organiser des informations et de promouvoir la gestion des connaissances » (Hodge, 2000). De fait, « briser les silos organisationnels » devient une nécessité pour le « laborantin » qui souhaite ouvrir le champ des possibles. Une fois identifiés, les signaux faibles doivent être interprétés dans le contexte de l’organisation et de son environnement (sectoriel, voire au-delà), incluant l’analyse des impacts potentiels sur les différentes parties de l’ensemble ainsi que la formulation de scénarios potentiels. En bref, la compilation, le croisement et l’analyse des données – informations permettent de confirmer l’idée (ou intuition) de départ, donc l’hypothèse de recherche.
Ainsi, ce que nous appelons « la recherche du signal perdu » nécessite une approche multi-temporelle : prendre le temps de stocker et d’analyser les data(s) multi sectorielles, qu’elles soient antérieures ou actuelles, pour mieux anticiper et interpréter les data(s) à venir…
Il s’agit donc de savoir concilier l’homme (pilotage) et la machine (recherche) ! Mais comment, au milieu de cet océan de data(s) et face à de multiples enjeux technologiques, éviter les erreurs de jugement et d’attribution humaine ?
1- Blanco S., De quelques signaux faibles à une veille anticipative utile à l'innovation de rupture, revue des Sciences de Gestion, 2008 (N°231-232)2 - Cahen P., https://www.archimag.com/veille-documentation/2015/02/06/interview-philippe-cahen-veille-numerisation3 - Les Tontons flingueurs de J. Audiard

2nde règle du protocole : les qualités et pièges de la fonction même du « laborantin »
Si le signal faible peut aider à imaginer, à prévoir des scénarios et parfois même à entrevoir une réalité naissante, son caractère non-déterminant a, toutefois, une incidence sur sa valeur : un signal faible a des attributs qui rendent sa détection difficile pour qui ne dispose pas des moyens et des qualités cognitives appropriées…
De formation supérieure, le « laborantin » a une réelle appétence pour l’observation des signes, fondée sur des connaissances transverses situées à la frontière de multiples champs disciplinaires en sciences humaines et sociales, pour être en mesure d’ausculter la réalité humaine individuelle et collective... Pour ce faire, il doit présenter de nombreuses qualités : capacité à collecter, traiter et interpréter de grandes quantités de données ; curiosité et esprit critique afin de remettre en cause d’apparentes évidences ; compétences en communication afin de valoriser l’information et la transmettre ; adaptabilité et agilité face à l’émergence de nouveaux outils / technologies de veille ; compétences linguistiques ; diplomatie et sens politique… Ainsi, la fonction de « laborantin » peut s’assimiler à celui du capteur d’insolite, de veilleur quasi « expérimental » : fonction délicate par nature, tant le potentiel du signal faible réside dans la capacité de celui qui le reçoit à l’interpréter, ainsi qu’à le mettre en relation avec d’autres éléments, pour lui donner du sens.
Toutefois, les sciences du comportement envahissent depuis quelques décennies de nombreux champs de la connaissance humaine, nous alertant sur les pièges inhérents à la fonction « d’oracle » :
De formation supérieure, le « laborantin » a une réelle appétence pour l’observation des signes, fondée sur des connaissances transverses situées à la frontière de multiples champs disciplinaires en sciences humaines et sociales, pour être en mesure d’ausculter la réalité humaine individuelle et collective... Pour ce faire, il doit présenter de nombreuses qualités : capacité à collecter, traiter et interpréter de grandes quantités de données ; curiosité et esprit critique afin de remettre en cause d’apparentes évidences ; compétences en communication afin de valoriser l’information et la transmettre ; adaptabilité et agilité face à l’émergence de nouveaux outils / technologies de veille ; compétences linguistiques ; diplomatie et sens politique… Ainsi, la fonction de « laborantin » peut s’assimiler à celui du capteur d’insolite, de veilleur quasi « expérimental » : fonction délicate par nature, tant le potentiel du signal faible réside dans la capacité de celui qui le reçoit à l’interpréter, ainsi qu’à le mettre en relation avec d’autres éléments, pour lui donner du sens.
Toutefois, les sciences du comportement envahissent depuis quelques décennies de nombreux champs de la connaissance humaine, nous alertant sur les pièges inhérents à la fonction « d’oracle » :
- 1) C’est ici que le protocole d’étude doit limiter la tentation du biais de reconstruction. Après tout, la détection de signaux faibles à postériori « ne serait-elle qu’une tentative de conserver un contrôle sur le futur en nous persuadant de sa préfiguration dès aujourd’hui »[[1]] ? Ne relève-t-elle pas encore de cette croyance en l’ordonnancement du monde tel qu’il va, structuré et déterminé ? Selon l’essayiste N.N. Taleb [[2]] , le biais rétrospectif est, selon lui, un mécanisme de déni du hasard dans lequel tout événement doit pouvoir se justifier afin d’être le plus prévisible possible, sa fonction étant dès lors de conforter les individus dans leur sentiment de contrôler l'incertitude. Etudiés notamment par les sciences de gestion, les principaux biais de reconstruction relèvent de la distorsion de la mémoire, de la surestimation de la prévisibilité d’un événement, et de l’impression que le résultat de l’événement devait nécessairement se produire. « Dans la plupart des cas, nous modifions les croyances que nous avions en lien avec l’événement avant son dénouement, et percevons après coup le dénouement de l’événement comme étant plus prévisible qu’il ne l’était » [[3]] . En bref, le biais rétrospectif consiste en une erreur de jugement cognitif désignant la tendance qu'ont les personnes à surestimer rétrospectivement le fait que les événements auraient pu être anticipés moyennant davantage de prévoyance ou de clairvoyance.
- 2) Cet ancrage dans une croyance erronée peut entraîner l’excès de confiance en son propre jugement. C’est la raison pour laquelle ce biais est aujourd'hui intégré dans des cursus ou des pratiques de consultance ou d'audit portant sur l'aide à la décision ou la gestion des risques dans des secteurs tels que l'économie, la politique, la finance ou la santé. Il s’agit donc ici de rappeler quelques principes de précaution dans le travail d’observation : d’abord ne jamais oublier la croyance initiale, le but de la recherche avant d’ancrer un avis post résultat ; ensuite, considérer les alternatives possibles à un événement en fondant son raisonnement sur le principe que celui-ci n’était pas forcément amené à se produire ; maintenir enfin son niveau d’expertise « transversale » par l’apprentissage permanent, le dialogue avec ses pairs, l’approfondissement de ses méthodes d’investigation en nourrissant une posture d’humilité… Bref, un travail ingrat qui nécessite un engagement sans faille autant qu’une lucidité sur soi, telle « cette blessure la plus rapprochée du soleil » selon le poète R. Char [[4]] .
- 3) Autre « biais cognitif » connu, le biais de confirmation s’exprime par la considération de faits confirmant les croyances de l’individu. Il s’agit d’un mécanisme cognitif incitant à privilégier une information confirmant une hypothèse. Autrement dit, le biais de confirmation est notre tendance à sélectionner uniquement les informations qui confirment des croyances ou des idées préexistantes. Il sera encore plus prononcé dans des contextes idéologiques, politiques ou les contextes sociaux chargés d’émotions. Dans ce contexte, si une information sort de son « propre cadre mental », le veilleur peut ignorer son intérêt réel. En bref, « C’est le Parrain de tous les biais cognitifs » [[5]] .
D’autres biais peuvent ici impacter la recherche du « laborantin », que ce format court de Chronique nous empêche d’approfondir (les défauts d’interprétation du langage, les stéréotypes véhiculés par un groupe social, l’ignorance des interdépendances et des effets dominos, le biais d’attribution ou encore « l’effet loupe »)… Pour résumer, retenons que les biais cognitifs entravent l’analyse des signaux faibles parce qu’ils distordent la manière dont l’information est traitée de manière rationnelle.
Toutefois, quand bien même cette étape de détection serait rationnellement réussie, qu’est-ce qui garantit vraiment l’exploitation, par l’organisation, d’informations étonnantes, parcellaires et souvent sujettes à caution ?
Toutefois, quand bien même cette étape de détection serait rationnellement réussie, qu’est-ce qui garantit vraiment l’exploitation, par l’organisation, d’informations étonnantes, parcellaires et souvent sujettes à caution ?
1- Portal T., Roux-Dufort C., Prévenir les crises, ces Cassandre(s) qu’il faut savoir écouter, 2013, Armand Colin – Elu « Meilleur essai » par la FNEGE en 20152 - N. Taleb NN., Le Cygne Noir, édition Les belles lettres, 20074 - Char R., Dans l’atelier du poète, Gallimard, 19965 - https://amaninthearena.com/biais-de-confirmation/

3ème règle du protocole : la transmission et la réception du signal dans l’organisation
Le rôle du « laborantin » est seulement de déceler : il ne décide pas du statut à donner à l’information, au « signal faible » ainsi révélé. Il décèle puis transmet une information qu’il juge intéressante à sa hiérarchie. C’est toute l’ambiguïté de son rôle ! De fait, en théorie, il tient sa légitimité à sa capacité d’établir des faits autant qu’à les faire valoir au sein de son organisation… Quand bien même le laborantin a trouvé sa « pépite », porteuse de sens, c’est à dire de risque ou d’opportunité, comment rendre crédible à sa hiérarchie une information réputée « fragile » ? Comment convaincre qu’il s’agit d’un signal crédible ?
Un des socles de l’analyse des signaux faibles est la circulation de l’information en interne, afin d’éviter son cloisonnement et de faciliter son exploitation ultérieure.
Un des socles de l’analyse des signaux faibles est la circulation de l’information en interne, afin d’éviter son cloisonnement et de faciliter son exploitation ultérieure.
- 1) Or, le laborantin est souvent victime d’une double peine :
- D’abord, l’information décelée est toujours considérée avec circonspection, par la hiérarchie, c’est à dire l’organisation. Surtout, le statut du veilleur ne protège pas en général celui qui s’y prête : celui-ci est toujours considéré avec surinterprétation par les hiérarchies et méfiance par les organisations.
- De fait, le porteur d’alerte n’existe QUE par son alerte ! Sa légitimité dans l’organisation tient à ce rôle délicat d’alerter sur des signes souvent inaudibles. A ce titre, le laborantin est-il un simple veilleur ou « un éveilleur » qui se demande : « à quoi cela va-t-il servir ? » [[1]]url:#_edn1 .
- 2) Ainsi, de multiples questions se posent sur le statut du veilleur :
- Qui encourage les « laborantins » en leur confiant les ressources nécessaires pour pérenniser un travail souvent ingrat, peu exploitable dans l’immédiat, qui n’épouse pas les préoccupations immédiates du métier de l’organisation ? Qui protège les « lanceurs d’alerte internes », les capteurs de signaux et les veilleurs dans la durée, sans remise en cause du bienfondé de leurs recherches ? De quelles reconnaissances bénéficient les veilleurs « laborantins » ?
- Qui intègre leur travail dans une échelle de gravité des risques pouvant affecter l’organisation ? Qui décide en dernier ressort de la validité de leur alerte ? Quel schéma idéal doit suivre l’information ainsi décelée afin de trouver écho dans l’organisation ? Quel niveau d’acceptation en interne est nécessaire pour faire valoir un signal porteur de sens ? Quelle organisation mettre en place pour permettre vraiment la prise en compte du travail de capteur ?
Cette Chronique 04 de notre « Petit Traité des signaux faibles » (rapportés aux crises) s’achève sur un constat : la nécessité de mettre en place un circuit de décision spécifique, avec ses gardes fous et aussi ses protections pour qui veut jouer le rôle du « laborantin ». Technique et chronophage, la « recherche du signal perdu » nécessite autant la mise à disposition de ressources de toutes natures que l’acceptation de « rapports minoritaires » par la hiérarchie. Il s’agit donc de mettre en place un véritable « process managérial » du signal faible, incluant sa recherche, sa détection, son interprétation, sa valorisation, sa transmission à la hiérarchie et sa priorisation par le décideur final.
Et bien souvent, là aussi, c’est une toute autre histoire, que nous aborderons dans la prochaine Chronique… Wait and see !
Bienvenu(e)s en Terra Incognita !
1 - Cahen P., opus cité

A propos de Thierry Portal
Gardez le lien
Lecturer, auteur primé FNEGE, direction pédagogique (Management des crises), chargé d’enseignement, Consultant senior Crisis Management, trainer et co-scénariste. Je suis passionné par le sujet des crises / risques depuis plus de trente ans : « indépendant, je forme, écris et conseille ».
Entre 2022 et 2024, j'ai co dirigé la pédagogie du MBA Management et communication de crise chez De Vinci Exedec (Prix Innovation 2022 et le Prix du Lancement Eduniversal 2023). Avant cela, j'intervenais déjà dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur (Master 2) dont : Paris Saclay (Sciences Po et droit), Panthéon Sorbonne (Ecole de Management / Gestion globale Risques et Crises), Ileri (Institut Libre des Relations Internationales et des Sciences Politiques), Université Technologique de Troyes (UTT) et diverses autres écoles et universités spécialisées en Cybersécurité, Ressources Humaines, Environnement, Communication, Commerce...
De 2001 à 2024 : près d'agences et cabinets conseils en communication sensible/crise, plus de vingt (20) années passées à décrypter les jeux d’acteurs dans l’écologie des organisations (exemple : intelligence économique - due diligence des parties prenantes), débroussailler les sujets complexes (ex : tendances puis scénarios à risques) et déminer les terrains délicats (ex : anticipation et signaux faibles annonciateurs de crise).
Auparavant, j’étais membre de plusieurs cabinets d'élus locaux avec comme mission essentielle la coordination municipale et la communication locale, en lien étroit avec le politique, les services et les administrés.
Ancien chargé de mission près du Ministère de l’écologie pour mettre en place les premières expérimentations d’information préventive sur les risques majeurs (ex : dicrim).
Lecturer, auteur primé FNEGE, direction pédagogique (Management des crises), chargé d’enseignement, Consultant senior Crisis Management, trainer et co-scénariste. Je suis passionné par le sujet des crises / risques depuis plus de trente ans : « indépendant, je forme, écris et conseille ».
Entre 2022 et 2024, j'ai co dirigé la pédagogie du MBA Management et communication de crise chez De Vinci Exedec (Prix Innovation 2022 et le Prix du Lancement Eduniversal 2023). Avant cela, j'intervenais déjà dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur (Master 2) dont : Paris Saclay (Sciences Po et droit), Panthéon Sorbonne (Ecole de Management / Gestion globale Risques et Crises), Ileri (Institut Libre des Relations Internationales et des Sciences Politiques), Université Technologique de Troyes (UTT) et diverses autres écoles et universités spécialisées en Cybersécurité, Ressources Humaines, Environnement, Communication, Commerce...
De 2001 à 2024 : près d'agences et cabinets conseils en communication sensible/crise, plus de vingt (20) années passées à décrypter les jeux d’acteurs dans l’écologie des organisations (exemple : intelligence économique - due diligence des parties prenantes), débroussailler les sujets complexes (ex : tendances puis scénarios à risques) et déminer les terrains délicats (ex : anticipation et signaux faibles annonciateurs de crise).
Auparavant, j’étais membre de plusieurs cabinets d'élus locaux avec comme mission essentielle la coordination municipale et la communication locale, en lien étroit avec le politique, les services et les administrés.
Ancien chargé de mission près du Ministère de l’écologie pour mettre en place les premières expérimentations d’information préventive sur les risques majeurs (ex : dicrim).

 Accueil
Accueil





