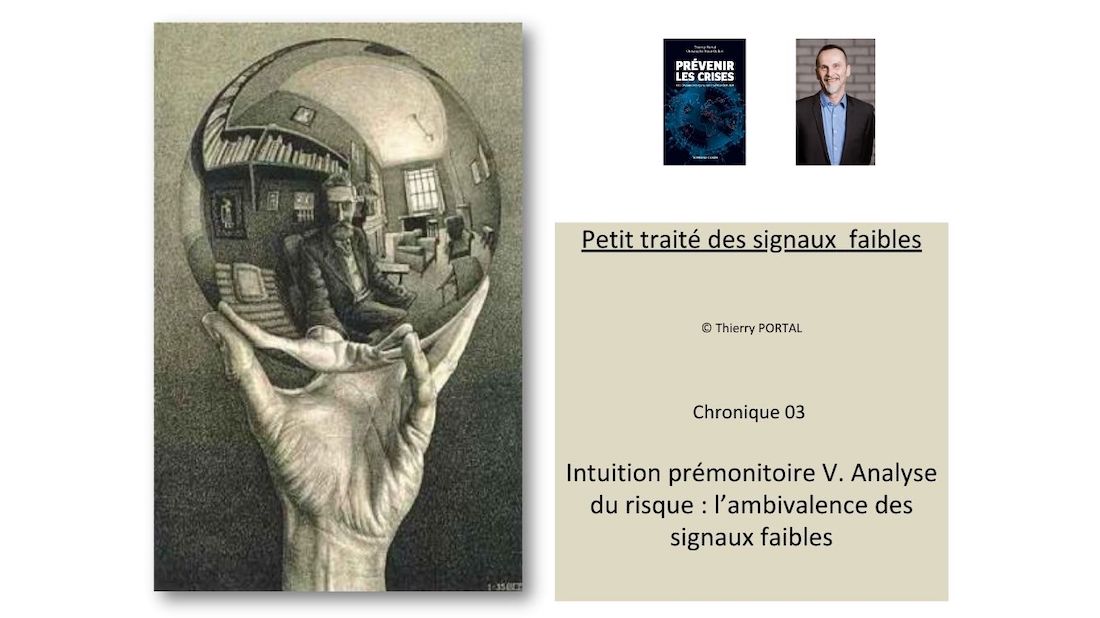
En partant d’exemples tragiquement célèbres, je vous propose de commencer à poser les bases d’une critique argumentée des signaux faibles appliqués aux crises. Le choix de porter ainsi notre regard sur ces évènements « historiques » relève de la pure raison : avant de voir dans les signes annonciateurs des oracles précoces et des solutions à tous nos problèmes, il est souhaitable de les analyser avec le recul nécessaire. Nous commencerons donc ici leur analyse « argumentée », qui prendra des bifurcations surprenantes au fil des chroniques, tout en apportant quelques pistes de réflexion et bonnes pratiques que les professionnels de l’information stratégique doivent avoir en tête.
De fait, nous allons voir dans cette chronique N° 03 que, quand bien même vos vigies et autres veilleurs ont fait leur travail de recherches et d’analyse, avoir décelé des « signaux faibles » ne suffit pas à faire changer une trajectoire d’organisation (publique ou privée)…
De fait, nous allons voir dans cette chronique N° 03 que, quand bien même vos vigies et autres veilleurs ont fait leur travail de recherches et d’analyse, avoir décelé des « signaux faibles » ne suffit pas à faire changer une trajectoire d’organisation (publique ou privée)…
Inondations de Valence, oct. 2024
Les FAITS - Dans la nuit du 28 au 29 octobre 2024, des pluies exceptionnelles ont affecté de vastes zones du pays valencien, provoquant d'importantes inondations. A plusieurs reprises dans le passé, l’Espagne avait affronté de tels cataclysmes. Cette fois ci, la décision de l'État central de ne pas élever le niveau d'alerte ni de décréter un état d'urgence relève du chevauchement des compétences administratives et des rivalités politiques.
Une telle mesure aurait certainement permis une réponse plus rapide et une mobilisation immédiate des ressources et des militaires, contournant ainsi les lenteurs de la gestion régionale. « Malgré des alertes anticipées de la part de l’Agence d’État de météorologie, le président de la communauté valencienne a minimisé la situation : demande tardive de l’activation de l’Unité Militaire d’Urgence et alertes non moins tardives sur les téléphones portables reçues près de deux heures après le début de la crue des fleuves Jucar et Magro »[[i]]
Une telle mesure aurait certainement permis une réponse plus rapide et une mobilisation immédiate des ressources et des militaires, contournant ainsi les lenteurs de la gestion régionale. « Malgré des alertes anticipées de la part de l’Agence d’État de météorologie, le président de la communauté valencienne a minimisé la situation : demande tardive de l’activation de l’Unité Militaire d’Urgence et alertes non moins tardives sur les téléphones portables reçues près de deux heures après le début de la crue des fleuves Jucar et Magro »[[i]]
[[i]] Claire Loïzzo, Alex Prados Linde, « Inondations dévastatrices à Valence : le révélateur d’une forte vulnérabilité en contexte méditerranéen », Géoconfluences, 13 novembre 2024.
Crise dite des « Subprimes » 2008
Les FAITS : l’étude historique des crises financières regorge de phénomènes d’éclatement de bulles spéculatives [[i]]- [[ii]] - [[iii]] . Déclenchée aux États-Unis en 2007-2008 par la chute de la banque Lehman Brothers, la crise des subprimes trouve son origine dans un excès d'endettement des particuliers. Du fait de l'interdépendance économique et financière entre les pays, elle s'est rapidement propagée au monde entier, impactant durement le marché mondial des crédits. « L’analyse des tenants de la bulle spéculative construite autour des subprimes et des produits titrisés montre en quoi la chaîne de causalité était en elle-même tout à fait rationnelle et donc intelligible et prévisible par les acteurs des marchés. Le côté rationnel des faits et de leur enchaînement est alors à mettre en parallèle avec toute une série de comportements et biais psychologiques » [[iv]] . Comme le dit B. Mandelbot : « Les catastrophes financières sont souvent dues à des phénomènes très visibles, mais que les experts n’ont pas voulu entendre »[[v]] .
[i] Portier E., chapitre Des crises financières à répétition (de 1929 à 2009) : étudier la finance comportementale pour changer de comportements, in Portal T., Crises et facteur humain, De Boeck Sup. col. Professional, 2009
[ii] Kindleberger C. a écrit plus d'une trentaine d'ouvrages d'histoire économique, dont le plus célèbre « Manias, Panics, and Crashes », traite des bulles spéculatives.
[iii] Boyer R, Dehove M., Plihon D., Les crises financières, Rapport pour le Conseil d'analyse économique, Paris, Documentation Française, 2004.
[iv] Rayne A. opus cité. "Prévenir les ruptures stratégiques : du bon usage des signaux faibles", Janvier 2009, L'Harmattan
[v] Benoît Mandelbrot Mathématicien franco-américain (théorie des fractales), Le Monde, octobre 2009
Attentats US du 11 Sept. 2001
Les FAITS : « Deux mois avant les attentats du 11 septembre 2001, un agent du FBI basé en Arizona alerte son siège : plusieurs individus originaires du Moyen-Orient s’entrainent dans une école d’aviation, ne souhaitant ni apprendre à décoller, ni à atterrir ! Il recommande une enquête nationale. Voilà un exemple typique de signal faible. Si le FBI central avait communiqué à ses agents de terrain qu’il soupçonnait une attaque impliquant des avions de ligne, l’officier rapportant un comportement étrange dans une école de pilotage aurait sûrement été écouté avec attention par sa hiérarchie. Or ce ne fût pas le cas : l’officier du FBI a bien transmis son rapport, jugé non urgent par sa hiérarchie » (source : P. Silberzahn [[i]]. Ecoutons l’expert Silberzahn : « Le sujet des apprentis terroristes (…) est symptomatique d’une chaîne de décision ‘défaillante’ pour traiter une information stratégique »[[ii]] .
[[i]] Silberzahn P., Survivre et prospérer dans un monde incertain : https://philippesilberzahn.com/2017/09/25/ne-comptez-pas-trop-sur-les-signaux-faibles-pour-anticiper-avenir/[[ii]] Silberzahn P., Bienvenue en incertitude, Diateino, 2021
Pearl Harbor, Décembre 1941
Les FAITS : Dans son ouvrage, Roberta Wohlstetter analyse l’ensemble des signes avant-coureurs parvenus aux radios américaines (qui avaient cassé les codes de communications japonaises) au cours des semaines précédant l’attaque et met en lumière les situations qui ont amené les autorités à ne pas en tenir compte pour se préparer à une potentielle attaque : « Pearl Harbor fournit un exemple tragique mais aujourd’hui bien documenté d’une attaque menant au plus foudroyant effet de surprise malgré́ le grand nombre de signaux qui la laissaient présager »[[i]] .
Quatre grandes crises donc, dont les signes annonciateurs n’ont pas résisté aux tamis mémoriels et organisationnels. Quels seraient les premiers enseignements, du point de vue de l’essence et de l’utilité de ces fameux précurseurs ? Peut-on céder à la tentation de croire en leur aptitude à déceler le risque, à anticiper le danger et à trouver des réponses efficaces dans des situations hors normes ?
Quatre grandes crises donc, dont les signes annonciateurs n’ont pas résisté aux tamis mémoriels et organisationnels. Quels seraient les premiers enseignements, du point de vue de l’essence et de l’utilité de ces fameux précurseurs ? Peut-on céder à la tentation de croire en leur aptitude à déceler le risque, à anticiper le danger et à trouver des réponses efficaces dans des situations hors normes ?
[[i]] Roberta Wohlstetter, Pearl Harbor : Warning and Decision, Stanford University Press, 1962

Quelles que soient les croyances qu’ils suscitent et les situations extra-ordinaires qu’ils seraient censés annoncer, les signaux faibles appliqués aux crises constituent un « objet de fascination » qui interroge notre vision du monde ainsi que nos capacités à faire face à ses risques...
- Une idée générique : il existe en sciences sociales une idée séduisante selon laquelle l’avenir sèmerait dans le présent des indices de son avènement. Appelés « signaux faibles », « signaux avant-coureurs » ou « précurseurs », ces indices contiendraient des fragments du futur qui, proprement décodés, permettraient de capter l’essence des changements qu’ils annoncent. C’est à Gaston Bachelard que l’on doit l’expression « syndrome » de Cassandre [[i]] , faisant référence à la croyance en la prédictibilité des choses...[[ii]]
- Une obligation face aux crises : cette idée de signaux faibles est particulièrement prégnante dans le domaine de l’étude des crises et des catastrophes. Ainsi procèdent-ils de cette tentative d’exploration des origines pour saisir, dans le présent, les traces des crises à venir… Surtout, si nous admettons qu’une crise peut être précédée d’une somme d’informations refusant de se laisser intégrer dans la synthèse des informations du quotidien et présentant un relief différent, alors nous sommes tenus de penser qu’il est possible d’agir avant que l’irréparable se produise. L’approche par les signaux faibles rehausse donc notre niveau de responsabilité face aux catastrophes ! Car l’idée selon laquelle des signes précurseurs pourraient annoncer la rupture nous invite à opérer une jonction entre la nature accidentelle et le caractère révélateur d’une crise, c’est-à-dire entre une perspective événementielle qui voit dans l’événement déclencheur un point de départ et une perspective qui considère l’événement comme le point d’arrivée d’une dynamique déstabilisatrice jusqu’alors ignorée. Ancrée sur une temporalité élargie, cette perception de la crise sous-entend une amélioration constante de sa gestion, endossée à un système incertain dans son fonctionnement même : à l’aune d’une certaine « prévisibilité », le management des risques doit plus que jamais se concentrer sur la prévention et l’anticipation, la formation et l’apprentissage en continu.
- Intuition ou prémonition ? : longtemps délaissé par les sciences de gestion, le mécanisme de l’intuition fait aujourd’hui l’objet d’un intérêt réel, notamment dans des contextes d’incertitude liés à une situation d’urgence ou de crise. Mais doit-on parler d’intuition ou de prémonition ?
- Ce mécanisme peut être « prémonitoire », en ce qu’il s’apparente à « la perception indépendante de quelque connaissance acquise ou inconsciente ». Comme le montre le psychiatre J. Barker dans les années 1960, le cerveau serait capable d’enregistrer à notre insu une somme phénoménale de détails minuscules, perdus dans la masse des informations extérieures (sons inaudibles, images fugaces, non-dits, microvibrations, odeurs, etc.). Au cours du sommeil, le cerveau ferait le tri, classerait les informations, établirait des corrélations, et pourrait ainsi prévoir des événements dont la logique nous est inaccessible à l’état de veille...
- On parlera cependant davantage d’intuition. Cette dernière n’est-elle pas, par essence, le réceptacle de signaux, annonciateurs d’enchaînements ? Comme l’explique G. Réty, ce mécanisme d’intelligence intuitive consiste en une « saisie immédiate d’une solution à un problème : elle est le résultat (…) d’une construction fulgurante non discursive », ce qui « permet d’offrir des options complémentaires souvent décisives et peut s’avérer plus puissant que le raisonnement habituel » [[iii]] . Sur la base des travaux du psychologue Gary Klein, il estime que « l’intuition implique une interprétation holistique de l’information et une reconnaissance implicite de la structure des problèmes et des relations entre les variables »
- Ce mécanisme peut être « prémonitoire », en ce qu’il s’apparente à « la perception indépendante de quelque connaissance acquise ou inconsciente ». Comme le montre le psychiatre J. Barker dans les années 1960, le cerveau serait capable d’enregistrer à notre insu une somme phénoménale de détails minuscules, perdus dans la masse des informations extérieures (sons inaudibles, images fugaces, non-dits, microvibrations, odeurs, etc.). Au cours du sommeil, le cerveau ferait le tri, classerait les informations, établirait des corrélations, et pourrait ainsi prévoir des événements dont la logique nous est inaccessible à l’état de veille...
[[i]] Gaston Bachelard, 1949, Le rationalisme appliqué, Paris, PUF[[ii]] Portal T., Roux-Dufort C., Dir., Prévenir les crises, ces Cassandre qu’il faut savoir écouter, Armand Colin, 2013
[[iii]] Réty G., Plaidoyer pour l’intuition en gestion de crise, Revue Défense Nationale , 2019, 68ème session
Il faut cependant rester conscient que cette idée, bien que séduisante, demeure contestable d’un point de vue méthodologique.
- Prévision ? Comment savoir qu’un signe est annonciateur du futur, qui plus est d’une crise, sinon qu’en présumant d’emblée l’occurrence d’un événement futur puis en lui attribuant des indices précurseurs cohérents et conformes à nos présomptions ? À ce titre, il convient de se demander si ce que nous qualifions de signaux annonciateurs d’une crise ne sont pas simplement une projection de nos psychismes angoissés par l’avenir. Les signaux faibles ne seraient-ils alors rien d’autre qu’une tentative de conserver un contrôle (illusion du contrôle ?) sur le futur en nous persuadant de sa préfiguration dès aujourd’hui ?
- Biais de reconstruction ? C’est bien là toute la difficulté d’une approche des crises par les signaux faibles qui souffre le plus souvent d’une limite méthodologique dont on trouve la source dans les procédés de reconstruction a posteriori des grandes crises et des grandes ruptures auxquels journalistes, scientifiques et politiques se livrent bien souvent. Il est ainsi toujours plus aisé d’attribuer des signes préalables à un événement dont on connaît ou redoute le résultat final. Surtout si l’événement en question est passé depuis longtemps à la trappe de « la mémoire du risque », oubli pur et simple de l’histoire comme il semble que cela soit le cas pour les inondations du valencien espagnol (crises antérieures : 1957 ; 1973 ; 1982 ; 1987) ou pour le risque d’éclatement d’une bulle spéculative (crises antérieures : 1929 ; 1987 ; 1997 ; 2001 avec Enron…) [[i]].
Dans ces deux cas, des critiques à bas bruit ont été émises par des associations citoyennes et des professionnels reconnus, des dysfonctionnements ont pu être identifiés par des politiques ou des régulateurs… L’impression persiste alors que la crise ne relève jamais du hasard, qu’on aurait pu, qu’on aurait dû la voir venir. Ces reconstructions sous-entendent trop souvent la coupable ignorance de ceux qui savaient ou qui auraient pu savoir et qui n’ont rien fait ou dit. En connaissant le résultat final, le tissage des indices préalables est biaisé et souvent à charge.
[[i]] Reinhart C., Rogoff K., 2010, Cette fois, c’est différent : huit siècles de folie financière, Paris, Pearson, coll. « Les temps changent »
Du point de vue épistémologique enfin, l’existence même du signal faible interroge notre état de compréhension du monde et de ses turpitudes.
- Pourquoi je cherche : Extraire des signaux faibles d’une masse énorme d’informations relève du pari, donc de l’idée plus ou moins claire de ce que l’on doit trouver : il faut savoir ce que l’on cherche, au minimum avoir une idée du but que l’on poursuit. C’est la question de l’objectif exprimé suffisamment distinctement pour entamer sérieusement un travail de recherche, d’analyse puis d’attribution à un type de risque. A propos de Pearl Harbor, selon Roberta Wohlstetter[[i]] , la marine américaine avait cassé les codes de télécommunications japonais, et donc ne pouvait ignorer qu’une opération d’envergure devait avoir lieu. Seulement, elle ne savait pas quand et où. Faute de précisions, le Pentagone refusa d’envisager une telle attaque, fondant son raisonnement sur « deux fortes hypothèses de départ (…) qui semblaient raisonnables à l’époque » : d’une part, « l’impossibilité technique des forces japonaises de se projeter à 6500 kms de leurs bases », et d’autre part, sur le caractère suicidaire d’une attaque d’un aussi petit pays que le Japon sur les puissants États-Unis. Et de nous apprendre qu’« un exercice de préparation est (…) refusé au commandement du Pacific ! » [[ii]] .
- Le poids de l’hypothèse : « ce ne sont donc pas les faits qui comptent », aussi subtils et utiles qu’ils puissent être, mais bien les hypothèses que l’on fonde, que l’on explique, que l’on fait évoluer également au fur et à mesure de l’étude d’une situation et sur lesquelles il s’agit de trouver des « preuves », des « éléments de certitude » pour prendre les meilleures décisions possibles : « sans hypothèse, impossible d’extraire les signaux faibles pertinents de la masse d’information ». Philippe Silberzahn cite ainsi le philosophe de la connaissance Haridimos Tsoukasen, qui surenchérit : « Comprendre présuppose l’existence d’un point d’Archimède, un point de vue à partir duquel le monde peut être considéré, pris en compte, et interprété. » Soupçonnant un acte de terrorisme futur, l’officier du FBI aurait été écouté si sa hiérarchie avait fait l’hypothèse d’une attaque de grande ampleur par avions de ligne : il n’en fût rien, considérant cette information peu importante dans un océan d’informations sensibles à digérer. Il en est probablement de même pour le commandement de la flotte du Pacific qui s’adressa fin 1941 à une autorité centrale, déconnectée des réalités certes, mais qui disposait du pouvoir de décision…
[[i]] Wohlstetter R., Pearl Harbor : Warning and Decision, Stanford University Press, 1962[[ii]] Silberzahn P., opus cité

Mais, au sens de l’analyse des risques, les signaux faibles ne constituent-ils pas une « énigme scientifique » ?
- Analyse rationnelle : comme l’exprime bien le chercheur C. Gilbert : « Certes stimulante, car obligeant à renouveler les approches de la gestion des risques et des crises, la problématique des signaux faibles pose cependant question. » [[i]]. De fait, les sciences dures, celles de l’ingénieur, prédominent encore dans l’analyse rationnelle des risques et utilisent pour ce faire des méthodes d’investigation et des outils d’analyse ayant fait leurs preuves, solides à la controverse qui s’accommodent peu de considérations sociales et politiques, exogènes par nature. Citons ici l’expert R. Amalberti [[ii]] [[iii]] pour qui il s’agit de construire, avant toute chose, « un savoir identifier et évaluer les risques, basé sur l’analyse de la fréquence et la gravité des conséquences de chaque risque ; des raffinements ont été introduits au fil des méthodes, en ajoutant par exemple la dimension détectabilité (AmDeC), mais sans changer fondamentalement l’approche (…) Un savoir décider qui permet de dresser une matrice de décision où chaque risque précédemment identifié va pouvoir être affecté à une grande famille de solutions de sécurité ». Ainsi en est-il par exemple d’une matrice des risques qui attribue à chaque événement un niveau de probabilité, de gravité, d’impact, d’occurrence, d’incidence générale, permettant ainsi une gradation dans la pyramide des risques globaux avec ses mesures de prévention et d’atténuation. Quid des signaux faibles dans un tel dispositif de connaissance ?
- Neutralisation des signaux faibles : de fait, plus une analyse de risque est qualitative, plus elle « neutralise » l’écoute des signaux faibles. Pour un auteur comme R. Amalberti, si un incident mineur apparaît, faisant l’objet d’un signalement faible et qu’il concerne un point jugé mineur par l’analyse de risque de départ, « cet incident apparaîtra logiquement comme une confirmation de la qualité de l’analyse de départ et non comme un signal inquiétant (puisque c’est un incident mineur) ». Autrement dit, « les signaux faibles sont (…) écartés (avec rationalité), faute de gravité ou de fréquence suffisante ».
- Signaux forts versus signaux faibles : certains diraient même (R. Amalberti ; C. Gilbert) qu’il y a certainement davantage d’accidents / d’évènements graves parce qu’on a choisi de ne pas écouter les « signaux forts » que de catastrophes dues à des micro signaux, aussi précurseurs soient-ils. Il en est ainsi des analystes financiers US, sourds aux risques systémiques décelés par quelques Cassandres éclairés comme le gestionnaire de fonds spéculatifs Michael Burry[[iv]] (qui les anticipe), le mathématicien Benoît Mandelbrot (qui les explique) ou encore « Le Sage d’Omaha », alias Warren Buffett (qui les évite) [[v]] . Il en est de même pour l’exécutif de la région de Valence, autant dans l’oubli de la mémoire du « risque inondation » à l’échelle de son territoire et dans l’ignorance des procédures d’urgence à appliquer que dans l’aveuglement aux signaux pourtant forts qui lui étaient adressés par la Météorologie espagnole. Surdité, aveuglement, ignorance… N’avons-nous pas déjà lu ces termes ensemble quelque part (Cf. Chronique 02 Crises et signaux faibles, Février 2025) ?
[[i]] Gilbert C., chapitre Entendre aussi les « signaux forts », in Prévenir les crises, ces Cassandre qu’il faut savoir écouter, Dir. Portal T., Roux-Dufort C., Armand Colin, 2013[[ii]] Amalberti R., chapitre Signaux faibles et sécurité pragmatique : les illusions d’un concept séduisant, in Prévenir les crises, ces Cassandres qu’il faut savoir écouter, Armand Colin, 2013, dir. Portal T. et Roux-Dufort C.[[iii]] Amalberti R., 2012, Piloter la sécurité, théories et pratiques sur les compromis et arbitrages nécessaires, Paris, Springer[[iv]] Cf. L’excellent The Big Short, film d’Adam McKay, sorti dans les salles en 2015. Lien wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Big_Short_:_Le_Casse_du_si%C3%A8cle[[v]]url:#_ednref5 Cohen E., Penser la crise, Fayard 2010
Et au sens de la fiabilité des systèmes, la prise en compte d’un signal faible reste encore marginale…
- Subjectivité du signal faible : selon l’école de Berkeley (théorie de la fiabilité) [[i]] , les signaux faibles seraient censés permettre l’amélioration de la gestion des risques, « exigeant désormais une attention accrue pour des dysfonctionnements ordinaires, peu visibles telles des déviances routinières ». Toutefois, dans une démarche aussi décisive que celle-ci, notons que la place du signal faible reste encore limitée, en général, aux « déviances ordinaires de l’organisation » et confinée à deux catégories de risques, subjectives par nature.
- Soit le signal faible s’est vu minimisé, voire « écarté de l’analyse rationnelle des risques » selon R. Amalberti : de nombreux exemples viennent à notre esprit, tel que l’explosion de la navette challenger en 1986, cas d’étude emblématique porté par D. Vaughan ou encore l’étude des « décisions absurdes », analysées par C. Morel (par exemple dans les accidentologies maritime ou aérienne) qui mettent en lumière l’enchainement de micro décisions qui vont dans le sens contraire au but recherché : « les erreurs radicales et persistantes ».
- Soit le signal faible fait partie de « risques émergents que certaines personnes physiques ou morales regrettent de n’avoir jamais vus traités par l’analyse rationnelle, alors qu’ils considèrent qu’il s’agit de risques prédictifs relatifs à des problèmes graves ». L’on reconnaîtra ici, outre le sujet générique des lanceurs d’alerte, les mille exemples de débats délicats comme celui de l’enfouissement des déchets radioactifs de très longue durée sur le site de Bure (Meuse) [[ii]], ou bien, à l’orée des années 2000, celui des ondes électromagnétiques (téléphonie mobile) sur lequel des réseaux comme Priartem et Robin des toits ont agrégé, jusqu’au Grenelle des Ondes en 2009, une multitude de communautés locales, des réseaux de recherche, des médias alternatifs pour contester les projets d’implantation [[iii]] .
- Soit le signal faible s’est vu minimisé, voire « écarté de l’analyse rationnelle des risques » selon R. Amalberti : de nombreux exemples viennent à notre esprit, tel que l’explosion de la navette challenger en 1986, cas d’étude emblématique porté par D. Vaughan ou encore l’étude des « décisions absurdes », analysées par C. Morel (par exemple dans les accidentologies maritime ou aérienne) qui mettent en lumière l’enchainement de micro décisions qui vont dans le sens contraire au but recherché : « les erreurs radicales et persistantes ».
[[i]] Vaughan D., 1996, The Challenger Launch Decision : Risky Technology, Culture and Deviance at NASA, Chicago, University of Chicago Press. ou encore Turner B., 1997, Man-Made Disaster, Oxford, Butterworth-heinemann.[[ii]] Plus long dossier dans la contestation du nucléaire en France, il trouve son origine dès le début des années ’80 lorsque l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), commence à étudier la possibilité d’un stockage souterrain. Ce conflit dure encore de nos jours, l’une des dernières péripéties judiciaires datant du 1er décembre 2023 avec l’avis positif du Conseil d’Etat sur le caractère d’utilité publique du projet de stockage.[[iii] Cette conflictualité grandissante a d’ailleurs donné lieu en 2009 au « Grenelle des Antennes relais » puis, des années après, à une loi (29 janvier 2015) encadrant beaucoup plus strictement les ondes électromagnétiques au travers de nombreuses obligations faites aux opérateurs (concertation, information, modification, compétences municipales renforcées…).
Que nous sommes-nous dits depuis le début de cette chronique ? Vous prendrez bien une petite synthèse ?
Nous sommes partis du principe que la crise contient à la fois les erreurs du passé, les drames du présent et les possibilités du futur ; rétrospectivement, elle éclaire son processus d’incubation et ses espoirs de recomposition. L’événement déclencheur de la crise constitue un point de jonction entre l’avant souvent ignorant de ce qui pourrait se tramer et l’après souvent ébranlé de sa découverte.
C’est la raison pour laquelle l’idée de signaux faibles appliqués aux crises est intéressante à poursuivre, même si elle est en rupture avec l’analyse classique des risques et encore peu intégrée par l’école de la fiabilité. De fait, s’il s’agit de déceler la possibilité d’une crise, non seulement faut-il savoir, mais surtout il faut croire à ces indices insidieux qui ne se présentent que rarement sous la forme d’une mise en demeure et n’offrent ni garantie ni certitude : les signaux faibles fournissent autant de raisons d’y croire que d’y renoncer. En prenant conscience de leur potentiel d’apprentissage, il revient à chacun de se faire son avis sur ces fameux « signaux faibles » !
Surtout, leur simple existence permet de vivifier l’espace « démocratique » en challengeant pratiques professionnelles et certitudes scientifiques au travers du « jeu » des critiques, controverses et autres polémiques. Les marges de manœuvre qui s’offrent ouvrent la voie à de multiples tractations cognitives, psychologiques, sociales et politiques, destinées à assimiler ou rejeter le signal. Cette vaste négociation collective prend du temps et expose souvent le signal, et sa source, à de nombreuses suspicions de la part de ceux, souvent nombreux, pour qui il(s) constitue(nt) une intrusion étonnante, une surprise stratégique, une évidente remise en question, voire dans certains cas une menace…
Dans la prochaine chronique, nous approfondirons ce cheminement critique sur l’idée de signal faible (appliqué aux crises)… Wait and see !
Bienvenu(e)s en Terra Incognita !
C’est la raison pour laquelle l’idée de signaux faibles appliqués aux crises est intéressante à poursuivre, même si elle est en rupture avec l’analyse classique des risques et encore peu intégrée par l’école de la fiabilité. De fait, s’il s’agit de déceler la possibilité d’une crise, non seulement faut-il savoir, mais surtout il faut croire à ces indices insidieux qui ne se présentent que rarement sous la forme d’une mise en demeure et n’offrent ni garantie ni certitude : les signaux faibles fournissent autant de raisons d’y croire que d’y renoncer. En prenant conscience de leur potentiel d’apprentissage, il revient à chacun de se faire son avis sur ces fameux « signaux faibles » !
Surtout, leur simple existence permet de vivifier l’espace « démocratique » en challengeant pratiques professionnelles et certitudes scientifiques au travers du « jeu » des critiques, controverses et autres polémiques. Les marges de manœuvre qui s’offrent ouvrent la voie à de multiples tractations cognitives, psychologiques, sociales et politiques, destinées à assimiler ou rejeter le signal. Cette vaste négociation collective prend du temps et expose souvent le signal, et sa source, à de nombreuses suspicions de la part de ceux, souvent nombreux, pour qui il(s) constitue(nt) une intrusion étonnante, une surprise stratégique, une évidente remise en question, voire dans certains cas une menace…
Dans la prochaine chronique, nous approfondirons ce cheminement critique sur l’idée de signal faible (appliqué aux crises)… Wait and see !
Bienvenu(e)s en Terra Incognita !
Récapitulatidf des Notes bibliographiques
[1] Claire Loïzzo, Alex Prados Linde, « Inondations dévastatrices à Valence : le révélateur d’une forte vulnérabilité en contexte méditerranéen », Géoconfluences, 13 novembre 2024.
[2] Portier E., chapitre Des crises financières à répétition (de 1929 à 2009) : étudier la finance comportementale pour changer de comportements, in Portal T., Crises et facteur humain, De Boeck Sup. col. Professional, 2009
[3] Kindleberger C. a écrit plus d’une trentaine d’ouvrages d’histoire économique, dont le plus célèbre « Manias, Panics, and Crashes », traite des bulles spéculatives.
[4] Boyer R, Dehove M., Plihon D., Les crises financières, Rapport pour le Conseil d’analyse économique, Paris, Documentation Française, 2004.
[5] Rayne A. opus cité
[6] Benoît Mandelbrot Mathématicien franco-américain (théorie des fractales), Le Monde, octobre 2009
[7] Silberzahn P., Survivre et prospérer dans un monde incertain : https://philippesilberzahn.com/2017/09/25/ne-comptez-pas-trop-sur-les-signaux-faibles-pour-anticiper-avenir/
[8] Silberzahn P., Bienvenue en incertitude, Diateino, 2021
[9] Roberta Wohlstetter, Pearl Harbor : Warning and Decision, Stanford University Press, 1962
[10] Gaston Bachelard, 1949, Le rationalisme appliqué, Paris, PUF
[11] Portal T., Roux-Dufort C., Dir., Prévenir les crises, ces Cassandre qu’il faut savoir écouter, Armand Colin, 2013
[12] Réty G., Plaidoyer pour l’intuition en gestion de crise, Revue Défense Nationale , 2019, 68ème session
[13] Reinhart C., Rogoff K., 2010, Cette fois, c’est différent : huit siècles de folie financière, Paris, Pearson, coll. « Les temps changent »
[14] Wohlstetter R., Pearl Harbor : Warning and Decision, Stanford University Press, 1962
[15] Silberzahn P., opus cité
[16] Gilbert C., chapitre Entendre aussi les « signaux forts », in Prévenir les crises, ces Cassandre qu’il faut savoir écouter, Dir. Portal T., Roux-Dufort C., Armand Colin, 2013
[17] Amalberti R., chapitre Signaux faibles et sécurité pragmatique : les illusions d’un concept séduisant, in Prévenir les crises, ces Cassandres qu’il faut savoir écouter, Armand Colin, 2013, dir. Portal T. et Roux-Dufort C.
[18] Amalberti R., 2012, Piloter la sécurité, théories et pratiques sur les compromis et arbitrages nécessaires, Paris, Springer
[19] Cf. L’excellent The Big Short, film d’Adam McKay, sorti dans les salles en 2015. Lien wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Big_Short_:_Le_Casse_du_si%C3%A8cle
[20] Cohen E., Penser la crise, Fayard 2010
[21] Vaughan D., 1996, The Challenger Launch Decision : Risky Technology, Culture and Deviance at NASA, Chicago, University of Chicago Press. ou encore Turner B., 1997, Man-Made Disaster, Oxford, Butterworth-heinemann.
[22] Plus long dossier dans la contestation du nucléaire en France, il trouve son origine dès le début des années ’80 lorsque l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), commence à étudier la possibilité d’un stockage souterrain. Ce conflit dure encore de nos jours, l’une des dernières péripéties judiciaires datant du 1er décembre 2023 avec l’avis positif du Conseil d’Etat sur le caractère d’utilité publique du projet de stockage.
[23] Cette conflictualité grandissante a d’ailleurs donné lieu en 2009 au « Grenelle des Antennes relais » puis, des années après, à une loi (29 janvier 2015) encadrant beaucoup plus strictement les ondes électromagnétiques au travers de nombreuses obligations faites aux opérateurs (concertation, information, modification, compétences municipales renforcées…).
[2] Portier E., chapitre Des crises financières à répétition (de 1929 à 2009) : étudier la finance comportementale pour changer de comportements, in Portal T., Crises et facteur humain, De Boeck Sup. col. Professional, 2009
[3] Kindleberger C. a écrit plus d’une trentaine d’ouvrages d’histoire économique, dont le plus célèbre « Manias, Panics, and Crashes », traite des bulles spéculatives.
[4] Boyer R, Dehove M., Plihon D., Les crises financières, Rapport pour le Conseil d’analyse économique, Paris, Documentation Française, 2004.
[5] Rayne A. opus cité
[6] Benoît Mandelbrot Mathématicien franco-américain (théorie des fractales), Le Monde, octobre 2009
[7] Silberzahn P., Survivre et prospérer dans un monde incertain : https://philippesilberzahn.com/2017/09/25/ne-comptez-pas-trop-sur-les-signaux-faibles-pour-anticiper-avenir/
[8] Silberzahn P., Bienvenue en incertitude, Diateino, 2021
[9] Roberta Wohlstetter, Pearl Harbor : Warning and Decision, Stanford University Press, 1962
[10] Gaston Bachelard, 1949, Le rationalisme appliqué, Paris, PUF
[11] Portal T., Roux-Dufort C., Dir., Prévenir les crises, ces Cassandre qu’il faut savoir écouter, Armand Colin, 2013
[12] Réty G., Plaidoyer pour l’intuition en gestion de crise, Revue Défense Nationale , 2019, 68ème session
[13] Reinhart C., Rogoff K., 2010, Cette fois, c’est différent : huit siècles de folie financière, Paris, Pearson, coll. « Les temps changent »
[14] Wohlstetter R., Pearl Harbor : Warning and Decision, Stanford University Press, 1962
[15] Silberzahn P., opus cité
[16] Gilbert C., chapitre Entendre aussi les « signaux forts », in Prévenir les crises, ces Cassandre qu’il faut savoir écouter, Dir. Portal T., Roux-Dufort C., Armand Colin, 2013
[17] Amalberti R., chapitre Signaux faibles et sécurité pragmatique : les illusions d’un concept séduisant, in Prévenir les crises, ces Cassandres qu’il faut savoir écouter, Armand Colin, 2013, dir. Portal T. et Roux-Dufort C.
[18] Amalberti R., 2012, Piloter la sécurité, théories et pratiques sur les compromis et arbitrages nécessaires, Paris, Springer
[19] Cf. L’excellent The Big Short, film d’Adam McKay, sorti dans les salles en 2015. Lien wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Big_Short_:_Le_Casse_du_si%C3%A8cle
[20] Cohen E., Penser la crise, Fayard 2010
[21] Vaughan D., 1996, The Challenger Launch Decision : Risky Technology, Culture and Deviance at NASA, Chicago, University of Chicago Press. ou encore Turner B., 1997, Man-Made Disaster, Oxford, Butterworth-heinemann.
[22] Plus long dossier dans la contestation du nucléaire en France, il trouve son origine dès le début des années ’80 lorsque l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra), commence à étudier la possibilité d’un stockage souterrain. Ce conflit dure encore de nos jours, l’une des dernières péripéties judiciaires datant du 1er décembre 2023 avec l’avis positif du Conseil d’Etat sur le caractère d’utilité publique du projet de stockage.
[23] Cette conflictualité grandissante a d’ailleurs donné lieu en 2009 au « Grenelle des Antennes relais » puis, des années après, à une loi (29 janvier 2015) encadrant beaucoup plus strictement les ondes électromagnétiques au travers de nombreuses obligations faites aux opérateurs (concertation, information, modification, compétences municipales renforcées…).
A propos de Thierry Portal
Gardez le contact : https://www.linkedin.com/in/thierry-portal/
Lecturer, auteur primé FNEGE, direction pédagogique (Management des crises), chargé d’enseignement, Consultant senior Crisis Management, trainer et co-scénariste. Je suis passionné par le sujet des crises / risques depuis plus de trente ans : « indépendant, je forme, écris et conseille ».
Entre 2022 et 2024, j'ai co-dirigé la pédagogie du MBA Management et communication de crise chez De Vinci Exedec (Prix Innovation 2022 et le Prix du Lancement Eduniversal 2023). Avant cela, j'intervenais déjà dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur (Master 2) dont : Paris Saclay (Sciences Po et droit), Panthéon Sorbonne (Ecole de Management / Gestion globale Risques et Crises), Ileri (Institut Libre des Relations Internationales et des Sciences Politiques), Université Technologique de Troyes (UTT) et diverses autres écoles et universités spécialisées en Cybersécurité, Ressources Humaines, Environnement, Communication, Commerce...
De 2001 à 2024 : près d'agences et cabinets conseils en communication sensible/crise, plus de vingt (20) années passées à décrypter les jeux d’acteurs dans l’écologie des organisations (exemple : intelligence économique - due diligence des parties prenantes), débroussailler les sujets complexes (ex : tendances puis scénarios à risques) et déminer les terrains délicats (ex : anticipation et signaux faibles annonciateurs de crise).
Auparavant, j’étais membre de plusieurs cabinets d'élus locaux avec comme mission essentielle la coordination municipale et la communication locale, en lien étroit avec le politique, les services et les administrés.
Ancien chargé de mission près du Ministère de l’écologie pour mettre en place les premières expérimentations d’information préventive sur les risques majeurs (ex : dicrim)

 Accueil
Accueil






