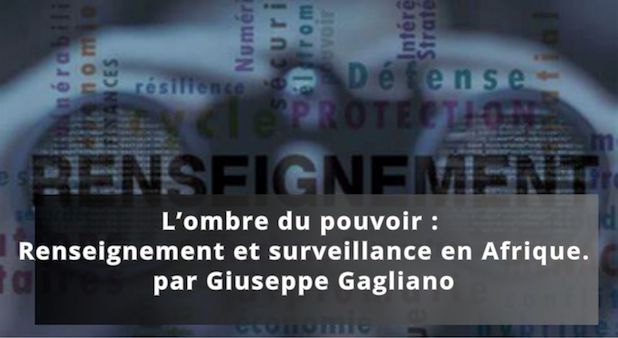
Technologies de surveillance et contrôle accru
Cette tendance s’est accentuée ces dernières années avec l’essor de la surveillance et de la répression des opposants politiques, des journalistes et des militants. La pandémie a offert un prétexte pour renforcer le contrôle des populations, avec l’achat par certains gouvernements de logiciels sophistiqués de surveillance auprès d’entreprises étrangères.
Le Kenya, par exemple, a adopté des outils avancés d’interception, dont le système Pegasus, pour surveiller les communications numériques, tandis que des sociétés israéliennes ont fourni des technologies permettant d’extraire des données et de surveiller les réseaux sociaux. Ces acquisitions, souvent réalisées dans la plus grande discrétion, ont renforcé la dépendance de nombreux États africains vis-à-vis de fournisseurs étrangers, rendant difficile tout retour en arrière.
Le Kenya, par exemple, a adopté des outils avancés d’interception, dont le système Pegasus, pour surveiller les communications numériques, tandis que des sociétés israéliennes ont fourni des technologies permettant d’extraire des données et de surveiller les réseaux sociaux. Ces acquisitions, souvent réalisées dans la plus grande discrétion, ont renforcé la dépendance de nombreux États africains vis-à-vis de fournisseurs étrangers, rendant difficile tout retour en arrière.
Les dangers d’enquêter sur les services de renseignement
Enquêter sur ces abus est une tâche périlleuse.
Le manque de transparence, la censure et un climat d’intimidation, rendent la collecte d’informations fiables extrêmement compliquée. Ceux qui tentent d’exposer ces pratiques font face à des menaces, des obstacles bureaucratiques et des risques de personnels.
Certains régimes, comme celui du Rwanda, illustrent parfaitement la manière dont les services de sécurité sont utilisés pour consolider le pouvoir et écraser toute dissidence sous couvert de stabilité nationale.
Documenter ces pratiques est un acte essentiel pour soutenir les démocraties fragiles du continent. Sans une opposition consciente et une société civile informée, ce sont les citoyens qui paieront le prix fort, exposés à un système de contrôle toujours plus sophistiqué et à une répression qui évolue avec l’introduction de nouvelles technologies de surveillance.
Le manque de transparence, la censure et un climat d’intimidation, rendent la collecte d’informations fiables extrêmement compliquée. Ceux qui tentent d’exposer ces pratiques font face à des menaces, des obstacles bureaucratiques et des risques de personnels.
Certains régimes, comme celui du Rwanda, illustrent parfaitement la manière dont les services de sécurité sont utilisés pour consolider le pouvoir et écraser toute dissidence sous couvert de stabilité nationale.
Documenter ces pratiques est un acte essentiel pour soutenir les démocraties fragiles du continent. Sans une opposition consciente et une société civile informée, ce sont les citoyens qui paieront le prix fort, exposés à un système de contrôle toujours plus sophistiqué et à une répression qui évolue avec l’introduction de nouvelles technologies de surveillance.
Une instrumentalisation des services à des fins politiques
Les services de renseignement africains fonctionnent dans un système où la frontière entre sécurité nationale et répression politique est de plus en plus floue.
Plutôt que d’être uniquement au service de la protection de l’État, ils sont souvent mobilisés pour garantir la survie des régimes en place, ciblant les opposants, les journalistes et les activistes.
Cette dynamique n’est pas récente : de nombreux services africains ont hérité des structures et des méthodes des puissances coloniales, les adaptant ensuite aux besoins politiques des gouvernements en place.
Plutôt que d’être uniquement au service de la protection de l’État, ils sont souvent mobilisés pour garantir la survie des régimes en place, ciblant les opposants, les journalistes et les activistes.
Cette dynamique n’est pas récente : de nombreux services africains ont hérité des structures et des méthodes des puissances coloniales, les adaptant ensuite aux besoins politiques des gouvernements en place.
Le cas du Rwanda : un appareil sécuritaire au service du régime
Le Rwanda en est un exemple frappant. L’assassinat de Patrick Karegeya, ancien chef des renseignements rwandais, en 2014 en Afrique du Sud, suivi des déclarations du président Paul Kagame, affirmant que “Les Traîtres n’échapperont jamais à la justice », illustre comment l’appareil sécuritaire est utilisé pour éliminer les menaces internes.
Une enquête menée en 2024 par le Collectif Forbidden Stories a mis en lumière l’étendue de la surveillance et de la répression exercées par le régime rwandais qui ne se limite pas aux frontières du pays mais s’étend à l’international.
Une enquête menée en 2024 par le Collectif Forbidden Stories a mis en lumière l’étendue de la surveillance et de la répression exercées par le régime rwandais qui ne se limite pas aux frontières du pays mais s’étend à l’international.
L’influence grandissante des services de renseignement dans la politique africaine
Ce mode de fonctionnement ne se limite pas au Rwanda. Dans de nombreux pays africains, les agences de sécurité sont devenues des instruments d’oppression politique, garantissant la survie des régimes plutôt que la protection des citoyens.
En Égypte, par exemple, les services de renseignement sont devenus une institution familiale, avec le président Abdel Fattaj Al-Sissi qui a placé son propre fils à la tête du General Intelligence Service (GIS), l’agence la plus puissante du pays. L’affaire de l’assassinat de Giulio Regeni en 2016, qui s’est déroulée dans le cadre d’une lutte interne entre factions rivales des services égyptiens, illustre bien comment ces structures fonctionnent hors de tout contrôle démocratique.
En Égypte, par exemple, les services de renseignement sont devenus une institution familiale, avec le président Abdel Fattaj Al-Sissi qui a placé son propre fils à la tête du General Intelligence Service (GIS), l’agence la plus puissante du pays. L’affaire de l’assassinat de Giulio Regeni en 2016, qui s’est déroulée dans le cadre d’une lutte interne entre factions rivales des services égyptiens, illustre bien comment ces structures fonctionnent hors de tout contrôle démocratique.
L’Afrique du Nord : des services de renseignement omniprésents
L’Afrique du Nord possède une longue tradition en matière de renseignement. L’Égypte, avec son General Intelligence Service, est l’une des agences les plus influentes du continent, gérant des dossiers sensibles comme la sécurité de Gaza, les relations avec la Libye et le Soudan, et la lutte contre les groupes dans le Sinaï.
Le Maroc et l’Algérie ont également développé des services de renseignement sophistiqués : la Direction Générale de la Sécurité Nationale (DGSN) en Algérie est réputée pour sa centralisation et son efficacité, tandis que le Département de la Documentation et de la Sécurité Extérieure (DGSE) marocain collabore activement avec les agences occidentales dans la lutte contre le terrorisme
Le Maroc et l’Algérie ont également développé des services de renseignement sophistiqués : la Direction Générale de la Sécurité Nationale (DGSN) en Algérie est réputée pour sa centralisation et son efficacité, tandis que le Département de la Documentation et de la Sécurité Extérieure (DGSE) marocain collabore activement avec les agences occidentales dans la lutte contre le terrorisme
L’adaptation des services aux nouvelles menaces sécuritaires
Dans d’autres régions, les services de renseignement africains ont dû s’adapter à de nouvelles menaces. Le Kenya a hérité des pratiques du Special Branch Britannique, renforçant son National Intelligence Service (NIS) pour contrer les attaques des islamistes somaliens Al-Shabaab.
En Afrique de l’Ouest, le Ghana s’est imposé comme un leader dans la cybersécurité avec sa Cyber Security Authority, tandis que le Nigeria a consolidé le rôle de sa National Intelligence Agency (NIA) dans la sécurité régionale.
En Afrique de l’Ouest, le Ghana s’est imposé comme un leader dans la cybersécurité avec sa Cyber Security Authority, tandis que le Nigeria a consolidé le rôle de sa National Intelligence Agency (NIA) dans la sécurité régionale.
Un manque de transparence et une instrumentalisation politique
Malgré ces avancées technologiques et l’utilisation croissante d’outils de surveillance avancés, les services de renseignement africains souffrent d’un manque chronique de transparence et d’autonomie. Souvent subordonnés aux besoins politiques des régimes en place, ils bénéficient de budgets inférieurs à ceux des forces de police et sont principalement utilisés pour réprimer l’opposition plutôt que pour assurer la sécurité nationale.
L’Érythrée, par exemple, a transformé son National Security Office en un système de surveillance de masse, comparable à celui de la Stasi en Allemagne de l’Est.
L’Érythrée, par exemple, a transformé son National Security Office en un système de surveillance de masse, comparable à celui de la Stasi en Allemagne de l’Est.
Dépendance aux puissances étrangères et enjeux géopolitiques
Un autre élément clé est la dépendance aux puissances étrangères.
De nombreux pays africains conservent des liens étroits avec leurs anciennes métropoles coloniales pour la formation et l’équipement de leurs services. Les pays francophones collaborent encore étroitement avec la France, tandis que ceux du Commonwealth maintiennent des relations stratégiques avec le Royaume-Uni et les États-Unis.
Mais d’autres puissances, comme la Russie, cherchent à s’insérer dans ce secteur, en exploitant les failles géopolitiques pour remplacer la France au Sahel, notamment via des opérations de renseignement et de déstabilisation ciblées.
De nombreux pays africains conservent des liens étroits avec leurs anciennes métropoles coloniales pour la formation et l’équipement de leurs services. Les pays francophones collaborent encore étroitement avec la France, tandis que ceux du Commonwealth maintiennent des relations stratégiques avec le Royaume-Uni et les États-Unis.
Mais d’autres puissances, comme la Russie, cherchent à s’insérer dans ce secteur, en exploitant les failles géopolitiques pour remplacer la France au Sahel, notamment via des opérations de renseignement et de déstabilisation ciblées.
Vers une réforme nécessaire des services de renseignement africains
L’Afrique tente depuis des années de renforcer la coopération entre ses agences de sécurité, notamment à travers le Committee of Intelligence and Security Services of Africa (CISSA) et la African Standby Force (ASF), mais ces initiatives restent largement marginales face aux crises régionales. Le défi reste majeur.
L’indépendance opérationnelle et la transparence sont nécessaires, afin que ces agences servent les citoyens et non uniquement les élites au pouvoir.
L’indépendance opérationnelle et la transparence sont nécessaires, afin que ces agences servent les citoyens et non uniquement les élites au pouvoir.
L’avenir du renseignement en Afrique : entre réforme et influence étrangère
L’avenir des services de renseignement africains dépendra de leur capacité à se réformer pour répondre aux défis de la sécurité moderne sans devenir des instruments de répression.
L’Afrique est au cœur d’une compétition géopolitique croissante, où les grandes puissances cherchent à asseoir leur influence à travers le renseignement.
Dans ce contexte, l’enjeu principal sera d’éviter que les services africains ne deviennent des pions dans un jeu global qui ne bénéficie ni à la stabilité ni aux populations locales.
L’Afrique est au cœur d’une compétition géopolitique croissante, où les grandes puissances cherchent à asseoir leur influence à travers le renseignement.
Dans ce contexte, l’enjeu principal sera d’éviter que les services africains ne deviennent des pions dans un jeu global qui ne bénéficie ni à la stabilité ni aux populations locales.
A propos de Guiseppe Gagliano
Giuseppe Gagliano a fondé en 2011 le réseau international Cestudec (Centre d'études stratégiques Carlo de Cristoforis), basé à Côme (Italie), dans le but d'étudier, dans une perspective réaliste, les dynamiques conflictuelles des relations internationales. Ce réseau met l'accent sur la dimension de l'intelligence et de la géopolitique, en s'inspirant des réflexions de Christian Harbulot, fondateur et directeur de l'École de Guerre Économique (EGE)
Il collabore avec le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) (Lien),https://cf2r.org/le-cf2r/gouvernance-du-cf2r/ et avec l'Université de Calabre dans le cadre du Master en Intelligence, et avec l'Iassp de Milan (Lien).https://www.iassp.org/team_master/giuseppe-gagliano/

 Accueil
Accueil







